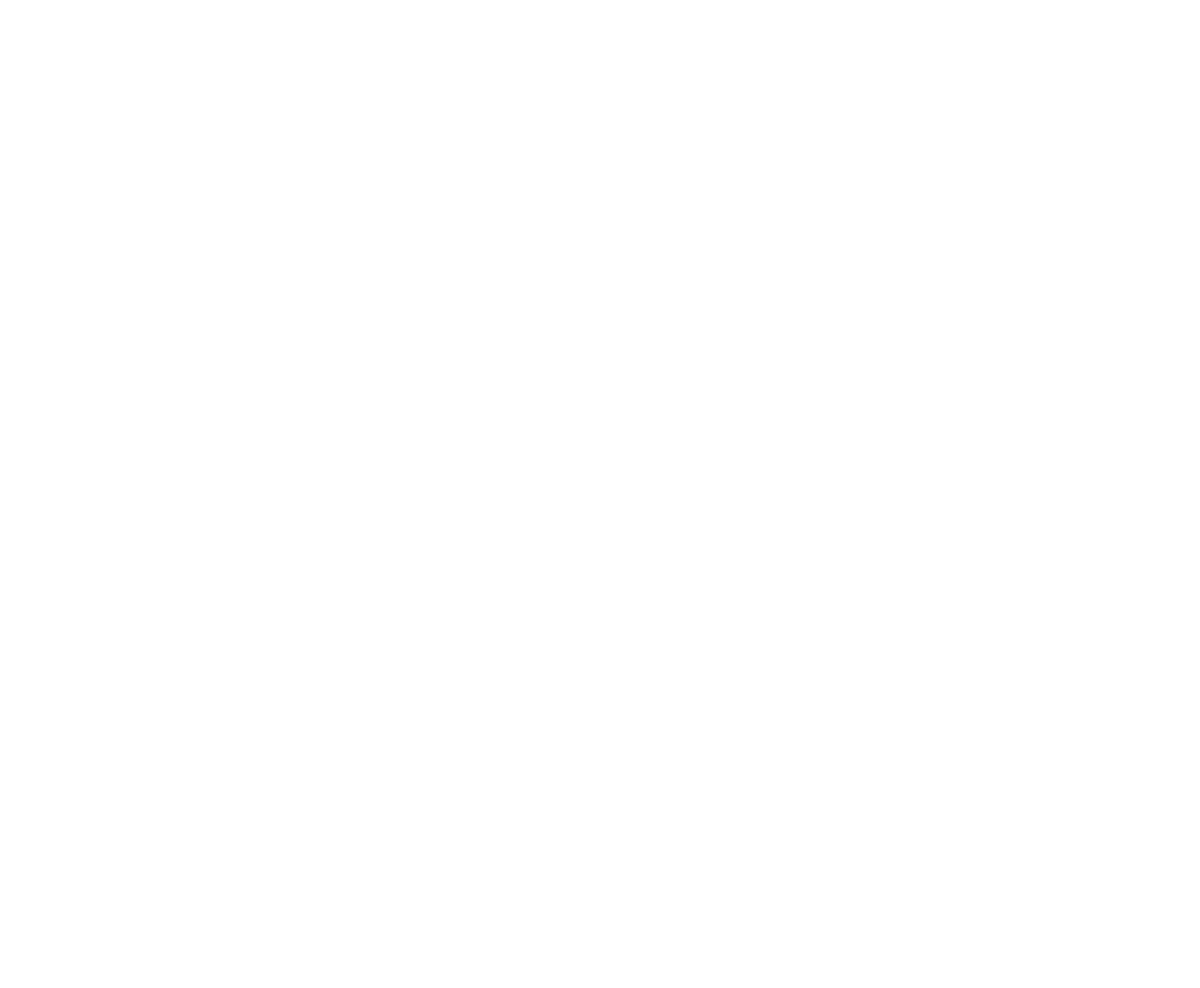Le mariage précoce : pour le pire et pour le pire.
À un âge où les autres filles jouent à la poupée, elles bercent leur bébé. Pendant que les autres filles écrivent sur leurs cahiers, elles assurent le rôle de femme au foyer. Elles ont entre 12 et 19 ans, à Madagascar, des petites filles forcées à se marier.
450 000* : c'est le nombre de filles ayant subi le mariage précoce à Madagascar. «Plus de 21000 d'entre elles sont âgées de 12 à 14 ans. Ce même rapport fait savoir que l'âge moyen du premier mariage des filles malgaches est de 15,9 ans.»
Pourquoi après l'adoption en 2018 de la Stratégie Nationale de Lutte contre le Mariage d’Enfants, (qui vise à réduire le taux de mariage d’enfants à 31% d’ici 2024) le mariage précoce demeure une pratique consentie ? Si les chiffres sont alarmants, ils représentent la partie émergée d'un phénomène de société.
Les statistiques mettent en lumière des cas qui restent dans l'ombre et le silence. Sur Facebook, le 11 octobre dernier ( Journée internationale de la fille), une internaute malgache a émis ce commentaire sur le sujet : «Les filles sont programmées pour être mère, plus elles se marient tôt, plus elles apprennent à prendre soin de leur foyer.» Cette réflexion reflète l'approche stéréotypée des filles et des garçons dans la société malgache.
Pour la consultante en genre et développement Mina Rakotoarindrasata, c’est à cause du poids des coutumes sur la loi que la pratique se perpétue : « La perpétuation des mariages précoces à Madagascar est très préoccupante malgré les efforts investis par l'Etat et les organisations de la société civile. Je pense que c'est parce que c'est profondément ancré dans notre culture. Même sur le plan légal, c'est seulement en 2007 que notre Code de la famille a ramené l'âge nubile à 18 ans pour les deux sexes. Auparavant, c'était 17 ans pour les garçons et 14 ans pour les filles. Et on sait tous que la plupart des unions à Madagascar sont des mariages coutumiers. Donc, cela passe sous le radar du contrôle du respect de l'âge nubile selon la loi. »
« Mon oncle m'a dit que j'étais en âge de me marier. Ils m'ont forcé. J'avais 14 ans. Je me suis enfuie». Confie Ravaka, les larmes aux yeux. Elle est partie de sa localité pour rejoindre la capitale avec l'aide de sa sœur aînée. Elle travaille maintenant comme aide ménagère. « Je veux encore étudier et un jour, ouvrir mon salon de coiffure. » Elle ajoute. « Je ne comprends pas pourquoi on force les enfants à se marier. »
Et à côté de ces incompréhensions, des pratiques subsistent dans tout Madagascar. Dans leur investigation sur le Mariage forcé dans le Sud, trois journalistes rapportent que seuls les noms varient en fonction des tribus. Valifofo et le Tsenan’ampela pour l’ethnie Bara dans le Sud, Moletry pour les Tsimihety au nord-ouest de Madagascar. « Des filles sont réservées par des hommes avant même leur naissance»**. Reléguant les filles comme des monnaies d'échange. Car oui, « C’est d’ailleurs devenu un business florissant pour les parents ayant des filles, ces parents les troquent contre des zébus. Des petites filles forcées d’épouser des hommes souvent appelés « patron-na omby » ( « patron de zébu » : traduction littérale) ou des hommes riches et propriétaires de cheptel pour combler le paupérisme des parents. Les petites filles n’ont pas de choix sauf d’accepter et d’être à la merci des hommes, au risque d’être reniées par leurs parents. »**
« Ma meilleure amie s'est mariée à 16 ans. Les parents de son mari ont donné des bœufs pour sa main. Elle en était triste. Elle voulait étudier le droit et devenir avocate. Des fois, elle en pleure encore. Elle a maintenant 2 enfants de 5 et 3 ans. » partage Onja, 22 ans, une jeune femme originaire de Tuléar ( dans le Sud de Madagascar), elle étudie la communication à l'Université d'Antananarivo. Elle ajoute en soupirant : « Le mariage est un choix. Si mon amie avait eu le choix, elle serait ici avec moi, étudiant le droit. »
Des rêves avortés, des droits bafoués, des aspirations hypothéquées pour être mari et femme, pour le pire et pour le pire.
Par Dina Nomena Andriarimanjaka
Journaliste et Ambassadrice de Nos Voix Comptent en Madagascar
* données sur l'Enfance à Madagascar (MICS 6) de l'UNICEF sorties en 2018.** Résultats des recherches de l'investigation menée par Nadia Raonimanalina, Elise Nandrasanela et Perle Ratsimbazafy sur le mariage forcé dans le Sud de Madagascar : https://www.malina.mg/fr/valifofo/.